Chapelet
Un chapelet est un objet de dévotion le plus souvent constitué de perles enfilées en collier sur un cordon. Il est utilisé par de nombreuses religions pour compter les prières récitées d'une manière répétitive en égrenant les perles qui peuvent...
Recherche sur Google Images :

Source image : tapouillon.blogspot.com Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Le chapelet est livré avec une image de St Benoit + l'explication.... Objet religieux chrétien : Chapelet Hématite véritable Chapelet de perles d'Hématite... Objet religieux chrétien : Collier Chapelet Cristal SWAROVSKI Boutique... (source : webmarchand)
- Ce joli chapelet est en bois Naturel, les grains sont sculptés, 50.... Ce chapelet - collier de Lourdes mesure 45 cm, les perles sont en nacre bleue.... (source : boutique-chretienne)
- la-boutique-religieuse store chapelet noir 40 cm ce chapelet est en plastique...... une perle du collier 0, 3mm couleur des grains du collier noir et jaune... (source : acheter-vendre.yakaz)
Un chapelet est un objet de dévotion le plus souvent constitué de perles enfilées en collier sur un cordon. Il est utilisé par de nombreuses religions pour compter les prières récitées d'une manière répétitive en égrenant les perles qui peuvent être constituées de toutes sortes de matériaux (bois, os, ivoire, métal, corail, émaux, perle…).
Étymologie
Le mot français chapelet est un dérivé du mot chapeau dont la forme ancienne était chapel. A l'origine (v. 1200) , il sert à désigner une coiffe, une couronne de fleurs et devient un terme à usage religieux par ressemblance avec les couronnes de roses dont on ornait la tête des statues mariales (cf. rosaire). Par ressemblance de forme, il sert à désigner un ensemble d'objets reliés entre eux en une sorte de chaîne. donne comme exemples : chapelet de saucisse, d'oignons, de piments…
Historique
Des colliers de perles, dents et coquillages ont souvent été trouvés dans les tombes antiques ou préhistoriques sans qu'on puisse leur accorder de signification religieuse.
L'usage d'un «collier de grains» pour prier est apparemment une invention indienne et remonte à la plus haute Antiquité. Il s'est répandu dans diverses religions : l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam mais aussi dans différentes formes de christianisme.
Fabrication
En Inde, selon un travail récent sur la pharmacopée respectant les traditions hindoue, les chapelets hindous étaient fabriqués non pas à partir des graines de l'Azadirachta indica (“Nimba” en sanscrit, et “neem” en hindi) qui était plutôt utilisé pour exorciser les démons et les esprits des morts, mais à partir d'Elæocarpus ganitrus (“Rudraksha” en sanscrit ou en hindi) [1].
Les bouddhistes (et certainement les brahmanes) ont utilisé les graines noires de Sapindus mukorossi (aux vertus purifiantes ; aussi utilisées pour produire un savon) [2].
Les graines de Cæsalpinia bonducella produisaient aussi des chapelets, perles de colliers et de bracelets [3].
Le fabricant de chapelets catholiques est dit Patenôtrier.
Différents types de chapelets

On peut distinguer :
- le chapelet catholique qui se compose de cinq dizaines de grains ; par métonymie, ce sont les prières qu'on récite avec un chapelet ;
- le tchotki, chapelet utilisé par les orthodoxes ;
- le lestovka, chapelet utilisé par les orthodoxes vieux-croyants ;
- le sabha ou misbaha, chapelet musulman qui compte quatre-vingt-dix-neuf grains quelquefois scindés en trois parties de trente-trois grains chacune (ceci par trois séparateurs : un grand et deux petits)
- le mâlâ, chapelet utilisé dans le bouddhisme et l'hindouisme, nommé aussi nenju juzu ou yu-dsu en Extrême-Orient, dont les cent-huit grains (27 dans l'amidisme) ont une signification symbolique ;
- le sikhisme utilise aussi une forme de mâlâ ainsi qu'une corde à quatre-vingt-dix-neuf nœuds.
Cet objet peut être représenté sous différentes formes (croix, collier, bague, corde…), en différents matériaux (bois, nacre, plastique, perle…).
Notes et références
Voir aussi
Bibliographie
- (fr) M. G. Konieczny, «La fabrication artisanale de chapelets dans la région d'Oltu (Turquie) et d'Asadabad (Iran). La technique, les outils, terminologie», Bæssler Archiv. Beiträge zur Volkerkunde Berlin, 1977, vol. 25, n° 2, p. 319-339.
Liens externes
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/04/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.





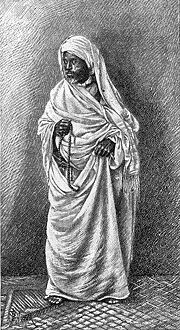

 Accueil
Accueil Recherche
Recherche Début page
Début page Contact
Contact Imprimer
Imprimer Accessibilité
Accessibilité